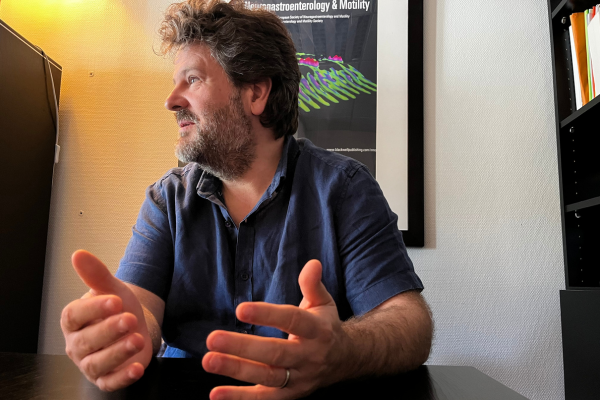
Le Pr Guillaume Gourcerol, médecin gastro-entérologue, chef de service, et chercheur, a récemment été lauréat d’une bourse de mobilité internationale financée par la Fondation Charles Nicolle pour partir pendant un an en Nouvelle-Zélande.
Pour commencer est-ce que vous pourriez rapidement vous présenter ?
Pr Gourcerol : « Bonjour, je suis médecin gastro-entérologue et chef du service de physiologie digestive, urinaire, respiratoire et de l’exercice du CHU de Rouen. A côté de mon activité clinique, j’effectue également des travaux de recherche en physiologie digestive au sein de l’unité Inserm 1073 (Université de Rouen), et m’intéresse particulièrement à une maladie digestive rare, la gastroparésie. »
Qu’est-ce qu’est la gastroparésie ?
« La gastroparésie est un trouble moteur de l’estomac se caractérisant par un ralentissement du passage des aliments de l’estomac vers l’intestin, sans qu’il n’y ait de blocage physique. Cela peut conduire à des nausées, des vomissements ou encore une sensation d’estomac plein après les repas. Les conséquences sont multiples : altération du statut nutritionnel (voire recours à la nutrition entérale ou parentérale), altération de la qualité de vie, augmentation des coûts de santé, surmortalité… D’où la nécessité d’étudier cette maladie, et la raison de ma mobilité internationale. »
Où allez-vous effectuer votre mobilité ?
« En Nouvelle-Zélande, plus précisément à l’université d’Auckland. Pendant 1 an ! »
Pourquoi la Nouvelle-Zélande ?
« Les équipes de recherche en Nouvelle-Zélande ont développé un nouvel outil, appelé Alimetry*, pouvant éventuellement être bénéfique pour les patients atteints de gastroparésie. Sur le plan scientifique, c’est là-bas qu’il faut aller. »
Quels sont vos objectifs là-bas ?
« Tout d’abord, se familiariser avec la technique. Comme elle ne peut pas encore être commercialisée en Europe, autant se rendre directement sur place ! Notre service a d’ores et déjà testé de nombreuses méthodes pour en évaluer l’efficacité. Pour continuer à développer la recherche, il est crucial de disposer des technologies les plus récentes et d’une plateforme d’exploration complète.
Ensuite, je vais tester la plus-value de cette technique par rapport à ce qui existe déjà. L’objectif est d’évaluer si cette technique permet de mieux distinguer les profils des patients afin de déterminer quel traitement serait par la suite le plus adapté à chacun. [voir l’encadré ci-dessous pour plus de détails]
Enfin, cette mobilité me permettra de développer mon réseau, ce qui est indispensable en recherche. En effet, la collaboration entre chercheurs est essentielle pour faire avancer la science et la médecine. »
Qu’attendez-vous de votre mobilité sur le plan personnel ?
« Après avoir beaucoup apprécié ma première mobilité à Los Angeles il y a quelques années, le souhait de renouveler cette expérience s’est naturellement manifesté. Pouvoir se consacrer pendant un an exclusivement à la recherche, sans les autres préoccupations de la vie d’un médecin, c’est une réelle « respiration scientifique » ! »
« Sur le plan scientifique, c’est là-bas qu’il faut aller ! » – Pr Gourcerol
En quoi l’allocation de mobilité apportera-t-elle un soutien ou un avantage à votre projet ?
« Partir pendant une longue période aussi loin, et dans un pays n’appartenant pas à l’UE, engendre beaucoup de coûts : billets d’avion aller-retour, VISA, frais d’école pour les enfants, couverture santé, etc. »
Quelles sont les retombées potentielles de votre mobilité ?
« Cette mobilité pourrait ouvrir la voie à de nouveaux projets de recherche, éventuellement en collaboration avec les équipes en Nouvelle-Zélande. De plus, je considère que le fait de pouvoir avoir une exposition à toutes ces innovations, fait qu’on gagne en notoriété. Cela se traduirait par plus de contrats de recherche avec le public et le privé, et mènerait aussi à un gain de notoriété pour le CHU de Rouen, qui serait vraiment reconnu pour cette maladie-là.
En parlant du CHU de Rouen, que vont concrètement apporter vos travaux à ses patients ?
« Dans l’immédiat, pas grand-chose (sourire). Par contre à terme, si la technique s’avère utile, les patients du CHU de Rouen pourraient y avoir un accès privilégié, puisque ce centre deviendrait le premier en France à l’adopter. Cette nouvelle approche pourrait soit remplacer des techniques déjà existantes, parfois plus invasives et moins confortables pour le patient, soit venir en complément des outils déjà disponibles. Les patients du CHU de Rouen pourraient donc bénéficier d’une meilleure prise en charge. »
Propos recueillis par Céline Heel
Alimetry est une technique qui consiste à enregistrer l’activité électrique de l’estomac. Cette activité, rythmée par un « pacemaker naturel », entraine environ 3 contractions musculaires par minute, nécessaires à la digestion. Alimetry, grâce à ses 64 électrodes placées sur la peau, permet d’obtenir une cartographie très précise non seulement du rythme de ce pace maker, mais aussi de la manière dont l’activité électrique se propage dans l’estomac. Cela permet d’obtenir des mesures beaucoup plus détaillées que les méthodes classiques.
Le Pr Gourcerol a identifié deux volets de recherche pour sa mobilité en Nouvelle-Zélande : le premier pour voir si Alimetry peut mettre en évidence la dysfonction du pylore, au lieu d’une exploration par endoflip sous anesthésie générale par voie endoscopique. Cela permettrait de simplifier le diagnostic. De plus, l’identification par Alimetry d’un profil de dysfonction pylorique chez les malades gastroparétiques pourrait permettre dans le futur d’orienter plus facilement les malades vers un geste thérapeutique ciblant le pylore. Son second volet de recherche porte sur l’évaluation de la capacité d’Alimetry à détecter les changements d’activité électrogastrographique au décours de la neurostimulation gastrique.
Si c’est le cas, on pourrait peut-être orienter les patients vers cette technique. De plus, il souhaiterait voir si certains paramètres permettent, soit avant l’implantation de prédire le succès thérapeutique, soit après l’implantation d’être associé au succès ou à l’échec de la thérapie. Cela pourrait optimiser les paramètres de neurostimulation gastrique, qui ont été pour l’heure déterminés de manière empirique.
Une belle opportunité pour le Pr Gourcerol de renforcer ses travaux et peut-être, à terme, d’améliorer la prise en charge des patients !